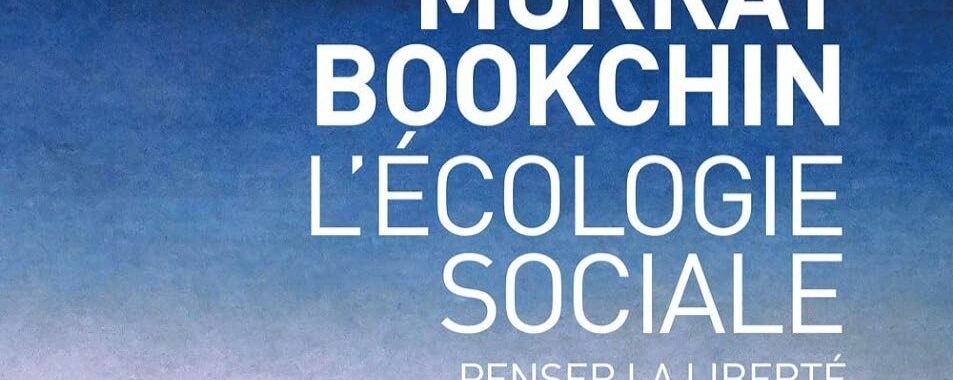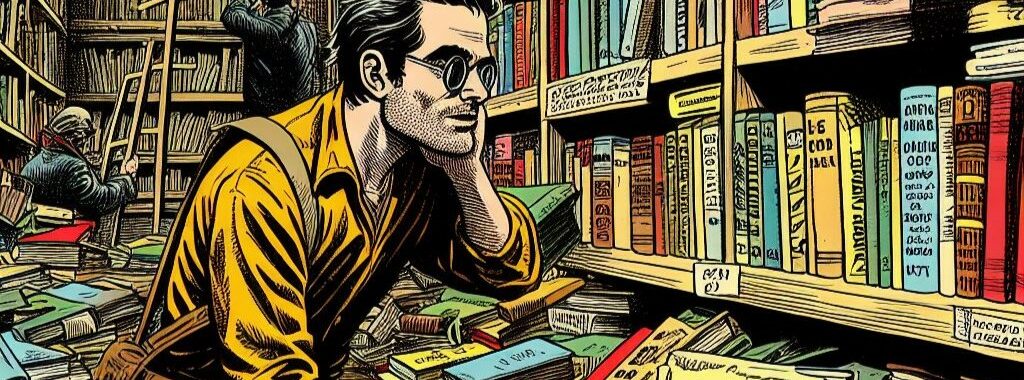Les tracteurs et leurs fourches sont de sortie, défilant en bloquant les grands axes routiers, salissant les grandes places, retournant les panneaux d’entrée de village, parés de leur fanion et de bâches sur lesquelles est peint le mot d’ordre « On marche sur la tête ». Mobilisation annoncée par celles des autres pays européens, d’abord localement comprises, elle s’est rapidement étendue à l’ensemble du territoire national sous la direction de la FNSEA, appuyée sur les sections plus régionales de la Coordination Rurale. Le mouvement est revendicatif avant tout, il serait la voix des paysans exacerbés par les contraintes bureaucratiques et normatives d’une administration française européenne toujours plus exigeante, suffocants sous les charges et impositions, exténués par un travail qui ne rémunère pas assez au vu des prix de vente dévalorisés, des coûts de fonctionnement et d’une productivité décroissante. Ce serait avant tout une question politique, pas seulement un ensemble de revendications corporatistes : les accords européens de marchés mondiaux et l’ouverture à la libre concurrence en son sein formerait une concurrence déloyale, immisçant de nouveaux acteurs externes sur leur niche de marchés traditionnels, au détriment de la qualité du produire français. Le problème écologique aussi se manifeste dans les énoncés récurrents de la revendication. Question imposée par le bobo citadin de gauche et une Europe déconnectée de la réalité du terrain, elle rend encore plus difficile le métier qu’il ne l’est déjà et accentue le sentiment intime de l’agriculteur dans le manque de considération pour son travail (il serait systématiquement le pollueur, ravageur de la nature, lui qui est à son contact tous les jours ; la polémique des mégabassines de cet été n’est pas là pour améliorer la chose).
Et comme toujours, une fois l’attention des médias attirée sur ce qui leur apparaît comme une nouvelle jacquerie, chacun, fort de son capital spectaculaire et de ses anecdotes personnelles, se permet d’avoir une opinion sur la question d’un monde qui depuis plus de 50 ans se meurt. Réveil spontané des consciences (qu’elles soient de gauche ou de droite, plus de 80% de la population française), où l’on s’émeut dans un sentimentalisme de crémière, en se disant soutenir un corps de métier, que chacun s’empresse de faire remarquer indispensable à la vie même, afin d’expressément témoigner de sa compréhension solidaire de la situation. On se délecte du traditionnel gala politique qui, à chaque mouvement social, essaye de tirer parti de l’affaire pour grappiller un bout d’électorat : les pseudos-gaullistes de la macronie cherchent à faire croire qu’ils ont compris ces gens qui travaillent en proposant des mesures compensatoires, la droite se réarme contre les charges salariales et le discours écologiste, la gauche et son utopisme se targuent d’une nécessité d’entamer la transition vers une agroécologie durable en accusant l’agroalimentaire et les gouvernements précédents, pendant que doucement l’extrême droite fait son nid avec chauvinisme… Ironie du sort, le siège de Paris fut tenté, alors que quasiment rien ne s’y joue et que la quasi-entièreté des décisions est prise à Bruxelles depuis 1992. Si un mouvement de grève est toujours un moment de questionnement sur le devenir concret des questions qu’il pose au politique, on peut légitimement s’interroger sur les perspectives (radicales ou non) de poursuite du mouvement et de ses divers enjeux, en élevant le débat au-delà des lieux communs que certaines avant-gardes savent si bien produire en se croyant puissamment théoriques. Plus que jamais, il faut rappeler la notion d’écologie sociale, car c’est elle qui nous permettra de déceler les rouages et d’expliquer une telle mobilisation.
Qu’est-ce donc ? Une jacquerie de plus ?
Alors que certains gauchistes se targuent de nuancer le propos, en rappelant le topo de l’opposition petit contre gros exploitants, essayant ainsi de reporter sur la situation le schéma incompatible de la lutte des classes, les fidèles chiens de garde de la droite (Eugénie Bastié et Emmanuelle Ducros en tête de gondole) hurlent à la vulnérabilisation d’un corps de métier de plus en plus déserté par la difficulté du travail, conditions causées par « l’éco-soviétisation » planifiée avec une insoutenable cadence par les verts européens. Bien heureusement, certains journalistes se dévouent corps et âme pour donner de la voix au terrain et ses revendications. On peut ainsi entendre l’éleveuse se plaindre de la non-convivialité de l’administration française, le responsable syndical accuser les traités transatlantiques d’offrir au consommateur français une nourriture de mauvaise qualité en comparaison avec la fameuse qualité de l’élevage français, et le céréalier réclamer un nouveau temps de répit dans l’abandon des phytosanitaires, plein de rancoeur envers les normes écologiques croissantes. Les prix de vente des produits et du gasoil entrent en contradiction, le libre-échange et les empires de l’agroalimentaire de la grande distribution sont dans le viseur. Le « Qu’on nous laisse tranquille ! » est repris de toute part. Ce mouvement témoigne de la diversité qui compose le monde agricole. Jeunes et plus âgées, petites, moyennes et grandes exploitations se réunissent autour de tablée improvisée sur les voies d’autoroute bloquées. Certains avec bonne foi énoncent la nécessité d’une agriculture qui doit produire mieux ; d’autres, plein d’amertume, après les propos d’Attal (qui dans son coup de com au délégué FNSEA de Haute-Garonne se contente d’énoncer une infime partie des revendications syndicales conduites depuis des années) cherchent à poursuivre la lutte, tous se sachant investis par leur vocation du lourd devoir de nourrir les foules. Cette lutte prend une forme plus ou moins violente selon la section et le syndicat chargé du secteur : pendaison de sanglier devant les préfectures et grand feu de pneumatiques pour la Coordination Rurale (témoignant une nouvelle fois de son ancrage historique dans la radicalité dorgériste), blocage de voie de communication et réception d’élu par la FNSEA qui cherche à conduire nationalement le mouvement en le faisant calmement converger vers Paris. La Confédération Paysanne avec hypocrisie essaye de passer la serpillière après avoir vu sa réputation salie aux yeux des siens (pour changer) ayant participé aux Soulèvement de la terre et à ses modalités d’action directe. Elle appelle à une manifestation calme et contrôlée du monde paysan, rappelant l’illusion qu’est le rejet colérique des normes face aux systèmes des seigneurs agroalimentaires, normes que leur figure historique José Bové a bien sûr contribué à édicter. Entre la manifestation pétition et la manifestation destruction, les agriculteurs veulent se faire entendre dans ce qui apparaît pour le novice comme un front paysan unique. Il y a presque un air cathartique à cette lutte, tournée vers l’État par défaut et dont la violence occasionnelle contre ses représentants (forces de l’ordre ou établissements) n’est jamais mise en correspondance égale à égale avec celles des émeutiers.
Fidèles à leur rôle, les syndicats couvrent de leurs haut-parleurs, la voix particulière des manifestants (certains se sont résignés et ne défilent pas) et il en devient impossible de comprendre clairement les raisons de la colère. On pourrait se complaire à tomber dans l’ancrage historique de ces mobilisations : ouverture au libre-marché, perte de débouchés, abandon de la fixation des prix, marges abusives de la grande distribution au regard de la rémunération des producteurs, charges fiscales excessives, coût de production excessif auquel se joint la perturbation ukrainienne, problème d’acquisition de foncier pour l’installation et son développement, autant de revendications traditionnelles qu’une frange radicale de la gauche renverra au poujadisme et à l’intérêt petit-bourgeois. Certains y voient l’émergence d’un mouvement de lutte d’un monde paysan (dont surpris j’apprend encore la vie dans les ruines) contre les géants agroalimentaires que la politique européenne veut imposer, réactivant ainsi le fantasme du Frexit (qui signerait enfin l’alliance entre les beaufs et les barbares au grand plaisir des Bouteldjistes). Que nenni ! Il en va simplement de réaffirmer leur dignité, rompre ce traumatisme transgénérationnel du paysan (vieille insulte) qui se sent plouc, déconsidéré, mal aimé et qui par ce moment d’exposition médiatique cherche les yeux doux d’une opinion publique déjà conquise (comme à chaque salon de l’agriculture) tout en se méfiant des politiques qui cherchent à s’accaparer leur lutte spécifiquement professionnelle. Ce grand capharnaüm surprendra à peine le Parisien dans sa routine et une fois les syndicats reçus à l’Élysée, il ne se passera sûrement plus rien, le temps du champ rappelant à nouveau le producteur à l’effort. Que dire de la CGT qui cherche la convergence en apportant un symbolique soutien de mot, sans grève. Elle ne fait surement que leur rappeler la rengaine de l’inutile fonctionnaire bureaucrate. Et les taxis qui jouent aux bouchons, dans une hypothétique coalition contre la concurrence déloyale des VTC. Tous ces défilés prennent la forme d’une mascarade en quête de responsabilisation du consommateur ; « CONSOMMER FRANÇAIS, PAS UBER ! ».
Comment lire la crise agricole à l’instar de ces mobilisations ?
« Pas de pays sans paysans » disent conjointement Attal et le cultivateur. Corps de métier historique à l’idée nationale (il faut aller chercher du côté de Barrès à ce sujet et dont la formule historique n’est autre que celle de Vichy avec le soutien décroissant de la paysannerie, à l’instar du reste de la population française), le monde agraire n’est bien sûr plus le même depuis la sortie de la guerre (si ce n’était pas le cas avant). L’industrialisation plus ou moins forcée du champ pour intensifier la production (processus dont l’apogée est l’ère gaulliste et l’investissement européen de masse dans la reconstruction) et la révolution chimique des années 70-80 sont les deux moments forts où va se signifier la supposée transition : celle faisant évoluer la figure du paysan vers la figure de l’agriculteur. Cette nuance sémantique est ici indispensable pour comprendre le renversement qui a eu lieu. Le paysan est une figure enracinée localement dans un terroir villageois, s’inscrivant dans une tradition familiale et affirmant une culture plus ou moins indigène mais leur étant propre, autour de l’unité villageoise. L’agriculteur est avant tout un producteur de ressources primaires, qui au moyen d’outils techniques modernes, se voit charger de la mission d’assurer l’approvisionnement en alimentation des masses, une fois les produits transformés par des complexes agro-industriels. Il faut bien entendre que l’entièreté des politiques passées en matière agraire est conduite de sorte à assurer la productivité (synonyme de rentabilité pour les consommateurs, la balance commerciale et en dernier le paysan), auquel se joint en parallèle la question de la souveraineté alimentaire (ironiquement européenne). Ce sont des politiques d’armement des campagnes, long processus d’introduction de la machine et du technicien des sols, des intrants et semences dans les fermes pour répondre à la demande industrielle en matières premières de toutes sortes dont les villes vont être abreuvées dans les grands étals des supermarchés.
Cette mainmise sur le monde rural par l’État trouve son syncrétisme dans les chambres d’agriculture, dont la compétence s’élargit toujours plus au fil du temps, entre deux réunions syndicales, où l’on se croise entre voisins de parcelles, entre deux discussions d’agronomie et de météorologie. Et si la virulence des manifestations se fait à l’égard de l’incompétence de ces institutions et de leurs gros ventres, comment expliquer que la FNSEA est toujours le syndicat de masse des agriculteurs, elle qui a ses habitudes dans ces lieux. Chercher à réhabiliter le schéma de la lutte des classes, dans la concurrence des gros contre les petits (réalité foncière perçue quotidiennement par eux dans la compétition mutuelle dans l’obtention des parcelles), cela n’est incapable d’effacer que c’est bien dans une soumission totale de la production à l’agroalimentaire que l’agriculteur se place. Et l’on s’étonnera que la FNSEA recherche l’accroissement des exploitations et des freins à l’environnementalisme européen alors même que la productivité doit être systématiquement amélioré (elle qui est de plus en plus décorrélé des prix d’achat aux agriculteurs sans l’être de celui de vente au consommateur) sur des hectares de moins en moins productifs (du fait peut-être de leur usus excessif). Il faut accroitre, la nouvelle réforme de la PAC y invite. Et ce n’est pas nouveau, c’est ce qui est dit depuis des années. Mythologie du toujours plus, funeste engrenage dans lequel les corps de ferme cherchent leur famine dans un suivisme mou dont certains accusent la fausse conscience de classe des agriculteurs. Certains en appellent à la nuance, la FNSEA comme tout bon syndicat et ses prétentions donc réformistes serait une mafia d’état, soutenant l’expansion des gros (alliés de taille des agro-industriels) au détriment des petits, contraint de toujours plus d’endettement du fait des investissements forcés que nécessite la compétition. S’il y a là une nouvelle fois une réalité parcimonieuse, peut-on vraiment qualifier de petit et traditionnel paysan, le laitier qui fort d’une exploitation de taille moyenne avec son troupeau de 70 bêtes et ses 60 hectares céréaliers abreuve incessamment Lactalis pour des prix médiocres au vu des efforts quotidiens ? Il n’a peut-être pas le choix des débouchés, c’est dans la tradition de la famille d’en être le fournisseur, la centrale ayant le monopole régional. Si le corps de métier se fait de plus en plus déserter, c’est peut-être tout autant dû au fait de sa non-rentabilité monétaire qu’aux difficiles et grégaires conditions d’exploitation. Et les modèles proposés comme alternatifs dans tout cela ? Le bio (que la profession a bâché pendant des années avant de déceler une part non négligeable de marché) se voit peu à peu intégré dans le modèle hégémonique de la surproduction, abandonnant toute voie de sortie positive pour les producteurs qui y cherchaient une revalorisation des prix et par cela de leur travail, supposément justifiée au vu de la perte des rendements. Et quand son marché se meurt, du fait d’une vie de plus en plus chère, d’une concurrence mondiale de moins en moins paritaire et d’un consommateur de moins en moins désirant être responsable, la filière n’échappe pas à la crise dont la fuite l’avait conduit à chercher à se structurer autrement, en quête d’un cycle plein de vertu.
Si le misérabilisme ambiant du discours actuel sur son métier donne à la figure de l’agriculteur d’être chargé d’un lourd pathos mélancolique, il permet aussi à l’agressivité de la contestation d’être traitée avec indulgence. Si l’on se veut matérialiste, la forme que prennent les contestations est indubitablement le reflet d’une position de l’agricole face au monde, cette fois-ci offensive : Le défilé en règle de la Tour Eiffel (symbiose unifiante du métier avec la nation entière, avant l’heure de gloire internationale des JO) ne peut faire oublier l’explosion du bâtiment de la direction de l’environnement à Montpellier ou les tentatives de blocage des villes et même de Rungis. L’histoire des contestations agricoles nous fait comprendre dans quel contexte la violence s’énonce : d’ordinaire plus pacifique depuis les années 1975 (les morts de Montredon ayant bien calmé les choses), les agriculteurs avaient depuis bien plus l’habitude de se structurer derrière une ligne de manifestation pétition, gouvernés nationalement par les syndicats négociateurs (tendance transversale à l’élaboration des mouvements paysans au fil de la constitution républicaine de la politisation nationale). Certains diront que l’émanation régionale de ce mouvement et sa violence polyforme témoignent justement d’un rejet d’une mouvance nationale « collaborationniste« , se sachant systématiquement trahis par les représentants syndicaux ? Peut-être mais c’est tout autant un cas de rejet du monde politique et citadin, sur fond d’antiparlementarisme européen, usé par le mépris fait de belles paroles des politiciens. Là s’explique le succès de la Coordination Rurale et son penchant ruraliste dans une bonne partie de la contestation, en se figurant syndicat alternatif des agriculteurs familiaux. Bloquer les villes, c’est prouver qu’ils en sont l’abreuvoir, que la campagne existe encore et qu’elle aurait aussi droit à exister. C’est la même tension ville-campagne dont on trouve le reflet dans les cartes nationales, avec ce coutumier décalage aux Républiques, entre les votes des deux espaces (ainsi, aux seconds tours présidentiels, l’équilibre des voix entre les deux candidats s’était bien plus équilibré loin des centres urbains). Pour que ces figures iconiques de la ruralité demandent à ce point à se faire reconnaître, en bloquant les lieux où il leur est impossible d’habiter (et donc d’exercer le moindre pouvoir et influence), cela doit sans aucun doute signifier que le ressentiment est fort, qu’existe l’impression d’une exclusion de l’espace public. Ce serait le nouveau chant du cygne de la France périphérique après les Gilets Jaunes, conduit une nouvelle fois par la France de l’essence contre celle de la livraison. Alors que l’urbain s’est étendu par sa ramification, le clivage historique opposant les deux espaces se formule enfin dans une ligne de front, celles des barrages routiers où la foule acclame ses héros à coup de klaxon ? Encore une fois, ce serait nier toute base élémentaire de géographie et de sociologie, l’hypermodernité associée à l’urbain se matérialise avant tout choses par des flux perpétuels et continus, conduits en canal guidé vers la métropole et que seule elle gouverne. Et bon, suffit de voir les lotissements, les supermarchés et la qualité des infrastructures pour comprendre que la banlieue et la campagne sont toutes les deux victimes de nos centres-villes et de leurs étalements urbains. C’est donc sûrement une géographie des élites que les émeutes se proposent de dessiner ? Eh non, toujours pas, la seule et unique raison, ce n’est pas la conquête du pain mais celle de son pain, bien gagner sa vie en produisant et se sentir reconsidéré. C’est dans ce sens qu’apparaissent des occupations de place publique aux airs de foire agricole (exposant bêtes et fourrages sous barnum), jamais là au fond pour dépasser cette imaginaire distinction ville-campagne.
On peut cependant noter encore une fois la richesse des modalités de contestations du monde agraire où triomphent parfois le rejet clair de l’industrie agroalimentaire (opération salissure d’un magasin d’une grande enseigne, blocage de centre laitier) et où se manifeste parfois la volonté de faire triompher la valeur d’usage sur la valeur d’échange (don de nourriture des camions interceptés avec de la nourriture étrangère aux restos du coeur, volonté de faire des opérations cadis gratuits en Languedoc). Cela, au grand dam des détracteurs coutumiers des agriculteurs (communistes puritains) auxquels ils prouvent leur capacité à embêter le pays, à conduire des révoltes et leurs aspirations de bon sens à une économie morale. C’est elle que l’on confond trop souvent, effacée derrière la remarque du « sans eux, on ne mange pas », comme si cette place prépondérante dans l’économie élémentaire de subsistance des sociétés était systématiquement synonyme d’une production et ingénierie assurant la vie…
Perspective d’avenir d’un mouvement, glas d’une crise écologique insoluble
Quelle solution ? Ce conflit généralisé à l’entièreté du territoire, où une nouvelle fois se manifeste la conflictualité entre l’État et la société civile peut-il conduire à un changement de paradigme ? Si l’on aimerait facilement espérer la convergence des luttes, (celles des petits bourgeois agricoles et routiers, avec le prolétariat urbain dans une grève générale en altérant les flux de communication et de production, réhabilitant ainsi le schéma historique de la lutte des classes qui trouverait son apogée dans une révolution), la conjecture actuelle semble nous faire démordre le contraire. Elle prouve seulement une appétence à la révolte, aspirant à un changement radical mais en rien la réalisation d’un tel projet. Car rien ne se met en place dans les luttes, on converge pour envoyer une pétition au gouvernement, qui choisira (comme il en va du statut du président-monarque) de nous accorder grâce ou non. En est-il seulement capable ? Il y a là un vrai problème de méthode. Au mieux nous ne pouvons espérer qu’une leçon à l’agro-industrie (bien trop épargnée dans ce mouvement, à la grande joie des CRS) en appliquant symboliquement la loi Egalim aux mauvais payeurs (loi déjà symbolique, responsabilisant surtout l’agriculteur dans l’octroi de ses prix). Et dire qu’il y en a qui rêvent expressément d’une nationalisation de l’agro-industrie, répondant une nouvelle fois au projet colbertiste de l’État français : la nation doit transformer les matières premières pour produire plus de richesses, afin de rééquilibrer une balance commerciale que le droit de la concurrence européen a définitivement déréglée. C’est la course à l’or quand la décroissance s’impose. Le fait d’en appeler à l’État révèle même ironiquement le paradoxe de ce mouvement ; plus de lois contre les directives, c’est-à-dire plus de régulation face au règlement. Cette stratégie, dû à la FNSEA et à sa direction nationale, témoigne de la faille systématique du syndicalisme, simple lobby auprès des instances décisionnelles. Et si la Confédération Paysanne a au moins le mérite de rappeler la vacuité de la formulation de la contestation des normes (celles-ci n’impactant que peu ses adhérents) pour le recentrer sur la valeur du travail, elle n’échappe en rien à la marchandisation spectaculaire en rentrant dans le pseudo-débat du petit contre le gros, cachant ainsi ceux des normes d’alimentations (que les éleveurs estiment souvent nécessaires afin d’en assurer la qualité) et l’enjeu sous-jacent de l’agroécologie. Ce n’est pas avec des AMAP et de la transformation directe, nécessitant une charge de travail importante que l’on va constituer un vrai progrès social pour le monde agraire.
Le mouvement est pourtant avant tout européen (le déplacement anecdotique des agriculteurs à Bruxelles en témoigne) : l’UE contrôle tout, a pris le relais dans la gestion de la production, alliant assistanat à la surproduction pour nourrir la mise en concurrence et l’écologie de contrôle, croyant préserver en figeant à un standard les environnements, leurs biodiversités et leurs sols. La perte de marché du bio (standard européen d’éco-responsabilisation du consommateur et du producteur) dans le contexte d’une inflation où la mise en concurrence de l’énergie joue une part plus qu’importante était prévisible. La PAC en fixant les usages des terres (entre autres) en échange d’une “bourse” est incapable de permettre l’arrêt du processus de dépaysanisation, en invitant seulement en leurs concentrations dans les mains d’un nombre de plus en plus réduit. Reflet d’une écologie normative de marché mondialisé (celle qu’un Félix Guattari nommait « capitalisme mondialement intégré ») qui accompagne parfaitement la fin du monde des paysanneries que l’abandon d’une économie capitaliste pure, foncière pour une économie financière entropique. La terre n’est plus vraiment une valeur en soi contrairement à ce que certains néo-physiocrates d’influence georgiste1 voudraient nous faire croire. Agricultures intensive et extensive forment alors un étrange mélange que seule l’Europe a su formuler (c’est d’ailleurs sûrement cette tension entre ces deux pôles qui conduit l’histoire générale de l’usage de la terre). Depuis de longues années, les paysans indiens luttent contre un morcellement de plus en plus important des terres, souvent accaparées par des seigneuries mais aussi pour une reconsidération de leurs revenus, alors même que la révolution verte fut opérée en garantissant une importante productivité. Comme quoi, la question conjointe des terres et de la valeur accordée à leurs productions est internationale. Le consommateur mondial n’a pas à payer (s’il le peut, vu le coût global de la vie) 50% de son pouvoir d’achat dans son besoin le plus élémentaire, il faut que sa libido se disperse, aille alimenter les autres marchés.
Comment concilier les enjeux de l’écologie et ceux de l’économie, mutuellement plus ou moins impératifs, sans provoquer systématiquement une fracture sociale ? Partons de la base, celle de l’espace agricole, que la crise met sur le devant du plateau. La crise continue se répand dans leur quotidien, celui d’une exploitation entre chapes grises de béton, outillages mécaniques couverts de boue et bâtiment de taule pour le stockage des foins et des bêtes. Triste nuancier de gris et de marron où le réveil se fait matinal, souvent sans le chant du coq, consacrant sa journée et sa vie conjugale au temps du labeur de l’ager. L’horizon, lisse des cimes des bosquets ou de l’étendue des champs comme seule contemplation quotidienne, du haut de leurs engins. La fatigue physique s’accumule au fil des âges, les temps de repos sont sociaux, autour d’une table où l’on partage un court verre à l’occasion duquel est évoquée la météo, la qualité des récoltes, les derniers investissements du voisin sur fond sonore du journal radio régional. La faune et la flore environnante, le paysage et le pays sont un fond diffus (alors qu’il est censé en tirer sa fierté et son identité), se résument souvent à l’évocation des nuisibles, dont l’extinction donnera lieu à l’un des rares moments communs de solidarité festive, par le partage presque potlatchien du banquet de l’association de chasse. Tristes campagnes signait Bernard Charbonneau, les courses se font comme tout le monde, au supermarché de la petite ville à proximité. Il jouit parfois du privilège d’être à la source ; les fameux produits du terroir, celui qu’il cultive. La nostalgie des anciens, transversalité structurante de l’ordre familial est alors une mémoire en larmes, mélasse des deuils des parents pour leurs enfants partis trop tôt, à la ville ou à la morgue. Une fois par semaine, le rendez-vous administratif a lieu – que cela soit l’agronome, le commercial, le contrôleur, le comptable, le juriste, le vétérinaire, le fournisseur et le collecteur. Ils lui transmettent l’impératif de l’investissement, du développement, qu’il reportera dans la sphère privée par l’acquisition d’un nouvel artefact (télé, fusil, fauteuil ou lave-vaisselle). La crise cherche à se voiler dans l’argent largement dépensé, avec plus ou moins de plaisir.
Au comptoir urbain, ça continue à parler de petit et de gros, tout en évoquant un proche et son arnaque à la PAC. Rien de tout cela n’est normal mais c’est un mouvement de plus, une anecdote de discussion. C’est une nouvelle fois un triomphe de l’événement (auquel nous nous joignons d’une certaine sorte) ; la merde aura beau être nettoyée des rues, elle restera dans l’assiette. C’est là sûrement la question qui est évincée du débat public. Il y a bien eu les états généraux de l’alimentation pour cela. Ce débat fut historiquement porté par les franges les plus révolutionnaires du monde agraire. Les jardins ouvriers et la Confédération Paysanne forment ici une seule et même ligne d’histoire. La Confédération Paysanne, émulation confédérale d’un petit nombre de syndicats régionaux (la fédération des paysans-travailleurs de l’ouest entre autres) s’opposant à la convergence entre la FNSEA et l’État, fit ses faits d’armes face à la militarisation des campagnes (le Larzac) et plus globalement l’intervention abusive de l’homme sur le champ et ses productions (lutte contre les OGM, affaire du Mcdo de Millau ou l’association précurseur au bio) avant de s’introduire dans des débats plus globaux comme la mondialisation, systématisant le tout dans une approche écologique anticapitaliste. Replaçant le paysan dans son rôle pittoresque, elle a le mérite au moins de placer le viseur sur l’ennemi, l’agroalimentaire et les pratiques qu’elle implique. Ce pôle souvent trop radical, nostalgique et gauchiste (aux yeux du métier) sert souvent aux discours politiques à se greffer, afin de formuler ses meilleures utopies. Si l’héritage de la figure de Bernard Lambert de la Confédération Paysanne est une fois de plus réaffirmé dans la problématique du remembrement parcellaire (le fameux débat des petits contre les gros et son imbrication dans la propriété d’usage de la terre), la solution qui en émane (d’un institutionnalisme qui ferait rougir le fondateur) se résume à mendier à l’état une fixation minimale des prix que le principe de marché unique européen annihile, en rêvant secrètement d’une loi foncière. Alors que la Confédération semble reprendre la relève dans le mouvement (après l’appel au calme de la Coordination Rurale et de la FNSEA), jamais le débat public ne formule la critique de l’impossible accès au pouvoir économique de l’agriculteur malgré l’impératif de la croissance du capital social, logique de sa responsabilisation d’entrepreneur. Jamais n’est formulé l’échec des modèles coopératifs et mutualistes (dont l’ignorant raffole par idéalisme). Jamais enfin n’est réellement questionnée la nature même du travail de l’agriculteur, qui en le renvoyant à la figure du paysan en oubli le travailleur et sa charge de travail digne du XIXe. C’était contre cette séparation que Bernard Lambert avait inventé la notion de « Travailleur-paysan« , invitant les fermiers à faire la jointure avec les travailleurs des villes de Mai 68 (en opposition à la FNSEA qui refusait le mélange avec la « racaille étudiante et ouvrière« ). Plaçant son discours dans son temps, il avait su constater la métamorphose du monde agraire par l’introduction des machines et la nouvelle valeur-travail contenue dans le produit-consommation. Malheureusement, le mouvement ne prend pas les airs d’une nouvelle grève du lait, ce n’est pas « les paysans contre leurs coopératives » mais plutôt « les agriculteurs contre les instances ». Les temps ont changé, l’ancien discours est bien incapable de renaître de ses cendres, le gouffre bureaucratique des syndicats trop agencé avec le schéma de pensée du libéralisme économique. Une partie des composantes du mouvement en est consciente mais impuissante, poursuivant le baroud d’honneur.
Ce nouveau statut de l’agriculteur qui ne peut se penser sans les instances agronomiques révèle sa pleine brisure. L’agronomie et son développement (dont on sait le passé colonial) trouvent d’abord sa raison d’être dans l’interventionnisme étatique avec une instance comme l’INRA (alliant recherche techno-biologique et communication avec le citoyen consommateur). Sa greffe sur le monde paysan ne s’est pas faite sans l’industriel et le banquier, prenant systématiquement par la main l’agriculteur pour la production de ses grandes cultures, en lui donnant les tous derniers conseils techniques. Elle incarne ainsi pour le monde agraire, le progrès scientifique, idéologie qui a par le passé détruit tant de savoirs traditionnels. Si un virage semble être pris ces derniers temps pour retrouver les pratiques traditionnelles (dont on se souvient subitement de leur résilience et efficacité relative), l’agronome reste incapable de s’émanciper de la tendance globalisante et de l’économie du savoir libéral qui accompagne l’ordonnancement de la production. Elle a beau communiquer, chercher à anticiper, accompagner le planning européen, le dialogue reste de sourd, le temps de la science toujours en avant (en avance ?) sur le temps de la pratique et en retard sur celui de la crise. Les bonnes intentions de protection de la société civile et de l’environnement, d’amélioration de la qualité et quantité de la production alimentaire sont au final autant de chiens de garde (car de plus en plus tournée vers le législateur et l’opinion publique, à la recherche de toujours plus de normativité) au contrôle par l’agroalimentaire du marché de l’alimentation. N’est-ce pas eux, les agronomes, qui ont sélectionné nos vaches pour leur donner un arrière-train volumineux bien rempli d’eau et des gras saturés de l’ensilage, assurant au commerce un apport important en pièces de choix (rumsteak, filet, bavette) mais entraînant du même fait la quasi-extinction de certaines races n’ayant pourtant rien à leur envier. Arrivés comme des messies dans nos exploitations, ils communiquent et expliquent avec autorité les nouvelles tendances à suivre afin de s’adapter aux difficultés à venir. La chaîne de production (où chaque acteur n’est qu’un module remplaçable) a pris le contrôle sur l’alimentation et nous voici résumé par le ménage de la distribution, nous abreuvant de la culture culinaire du burger : steak haché surgelé, fromage fade, pain blanc, frites ; quelle pauvreté !
Finalement, que ressortir de tout cet émoi ? La grève s’émousse, elle est difficile. Le débat public la rend stérile. Malgré les contre-points tentés ici, les questions ne sont finalement plus posées, les discussions et échanges bien trop cristallisés par la polémique et ses acteurs de leurs lourdeurs démagogiques. L’écologie en transparence, l’inégalité sociale en façade, voilà à quoi le mouvement peut se résumer. Si la société civile se fait favorable à plus de normes écologiques (par exemple le glyphosate), elle oublie au fond que leur introduction doit s’accompagner d’une mutation totale et complexe du système d’alimentation, transformation qu’elle n’est pas forcément prête à assumer au vu des modalités de consommation de masse qui la gouvernent, se déchargeant de ce poids vers l’État. De toute façon, une condamnation du citoyen est illusoire, certains isolés, tentent déjà la sociale – par exemple avec la sécurité sociale de l’alimentation. La dynamique n’est donc pas vraiment à l’écologie sociale du fait de la tendance de la gouverne mondiale mais également du fait les modalités de contestation qui se sont modulées durant cet épisode, chaque camp capitalisant en vue d’appliquer son programme, aliénant ainsi le triste réel, incapable de dialectiser avec celui-ci. La solidarité est de principe. Personne (et peut-être par la faute même des agriculteurs) n’a pu vraiment faire entendre sa voix dans ce mouvement, facilitant ainsi l’isolement corporatiste qui fait du corps agraire une force résiduelle.
Là est tout l’intérêt d’une perspective communaliste dont l’histoire a prouvé qu’elle était capable de repenser localement la production et la distribution au-delà du cadre marchand (la commune de Nantes de mai 68 en est peut-être le meilleur exemple). Sans elle, jamais l’agriculteur ne sortira de son statut, base structurante de l’organisation moderne de la vie quotidienne. En ne questionnant ni la technologie agraire, ni la distribution des productions, en refusant de les entendre comme des usages socialement compris et comme des phénomènes soutenant l’accaparement des terres et du travail des fermiers, nous nous résoudrons au simple constat d’une crise perpétuelle que le faible droit ne peut plus compenser. Il faut dépasser cette normalisation totale de la situation, qui au final n’offre qu’un mutisme amer et sec, incapable de dénommer pleinement l’agriculteur de la charge dont il est dévoué. C’est un nourricier. Il doit prendre soin malgré l’altération obligatoire des environnements et nous apporter de quoi nous sustenter, en accompagnant la croissance de l’utile faune et flore. La perspective de proximité est en cela à privilégier car permettant d’énoncer ce lien, de reconnaître et soutenir l’engagement qu’un changement de paradigme implique pour la société, sans tomber dans le nostalgisme de la place de marché et de l’exploitation familiale. L’intelligence collective doit être de mise pour réinventer les pratiques et usages, alliance socialement intégrée par la pratique de la démocratie directe entre les producteurs, les ingénieurs, les distributeurs et le reste de la société civile afin de créer une équité sociale de la valeur-travail et une écologie surgissant de la base, affluente de diversité ; en somme : afin de constituer les voies d’une émancipation durable et apaisée pour l’entièreté de la société civile, par la profusion de ses imaginaires. Si l’on put constater dans cet épisode, des moments de joie et de partage sur les blocages de centres d’approvisionnement et ce que l’on s’amusera à nommer des ZAD d’autoroute, ces blocages prennent des airs insignifiants au vu du gigantisme des échanges et de l’organisation mondiale du modèle de marché agro-industriel. Ce fil de l’histoire suit tranquillement son cours, en attendant le crack…
En espérant que le nécessaire sera fait, avant.